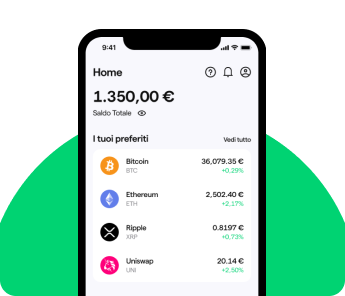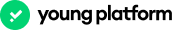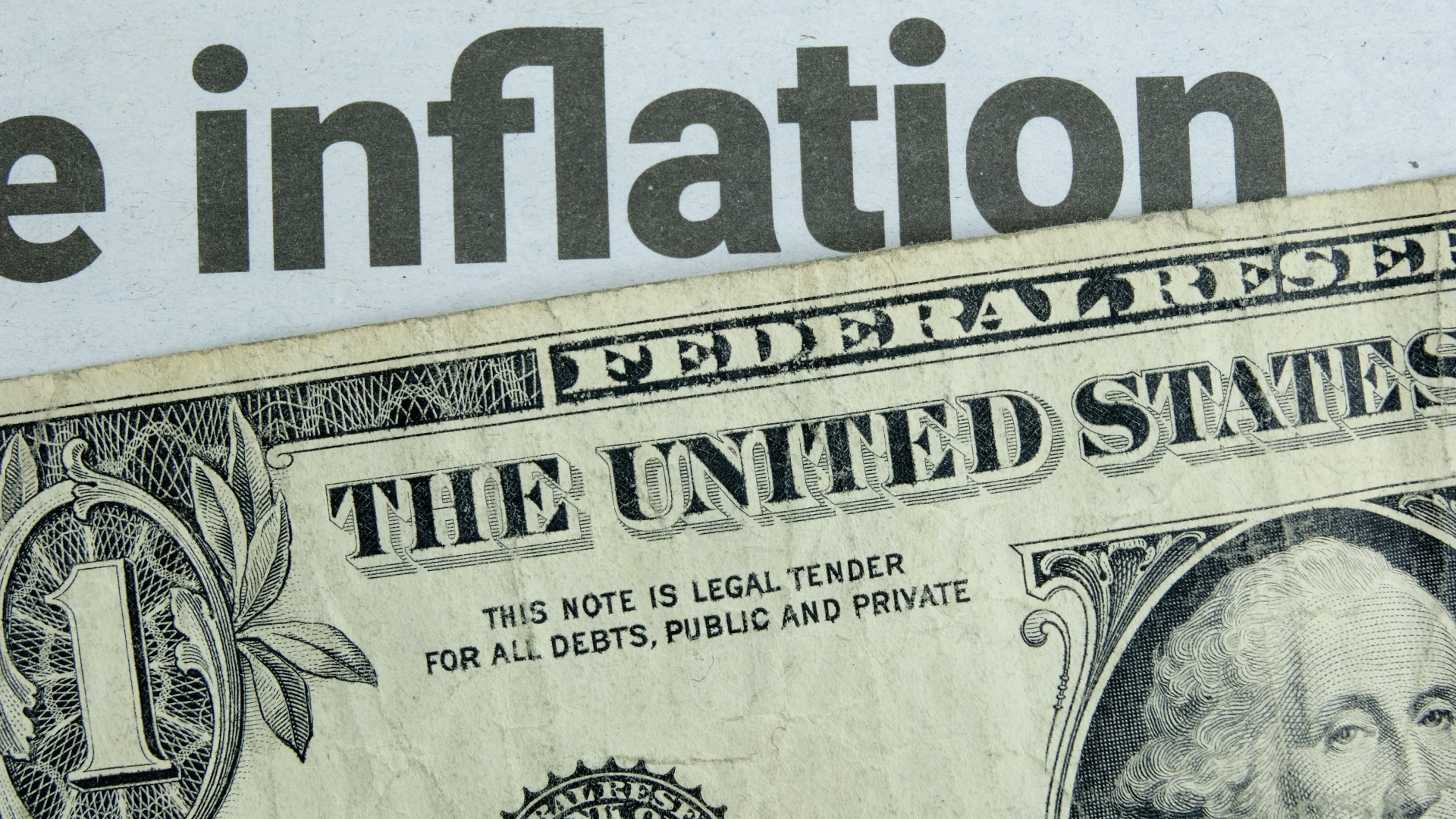Le rapport du 4e trimestre 2025 consacré au token YNG : que s’est-il passé au cours d’une année 2025 pleine de nouveautés, et quelles sont les prochaines étapes à enclencher ?
Que s’est-il passé au dernier trimestre ? Quels ont été tous les objectifs atteints en 2025 ? Qu’est-ce qui nous attend en 2026 — une année décisive pour notre avenir ? Combien de tokens YNG ont été émis, achetés et vendus, et quels sont les prochains pas à accomplir ?
2026 chez Young Platform
2025 n’a pas été seulement l’année du tournant que nous avions promis : c’est l’année où nous avons redéfini notre horizon. Il y a douze mois, notre roadmap était une trajectoire ambitieuse ; aujourd’hui, elle est devenue la colonne vertébrale d’un écosystème sans équivalent en Italie. Nous ne nous sommes pas contentés de suivre un chemin déjà balisé : nous avons choisi d’évoluer à la vitesse que le marché impose.
Comme l’enseigne Peter Thiel dans le célèbre Zero to One, le vrai progrès ne consiste pas à copier ce qui existe déjà, mais à passer de zéro à un — créer quelque chose de réellement nouveau. Viser haut nous a permis, même en manquant quelques objectifs intermédiaires, d’atteindre un endroit qu’on n’aurait jamais pu imaginer au départ.
L’évolution la plus radicale concerne le compte de paiement et la carte de débit. Lancés officiellement en novembre pour le Club Platinum et pour les gagnants des concours, ils entreront en phase de déploiement pour les autres Clubs à partir de la deuxième semaine de février.
Qu’est-ce que vous trouverez dans ce rapport ? Évidemment, comme le titre l’annonce, le protagoniste, c’est le token Young (YNG). Après des années de construction, 2025 a été l’année de sa consécration.
Le listing sur Uniswap a été l’étincelle qui a déclenché la phase d’expansion la plus explosive de son histoire.
Et ensuite ? Bien plus encore : des concours qui nous ont accompagnés jusqu’au lancement de la carte, jusqu’à la naissance d’un nouveau Club — aujourd’hui une porte d’accès privilégiée à notre écosystème. Enfin, une étape institutionnelle majeure : le dépôt officiel du filing de la licence MiCA. Vous trouverez les détails de ce parcours et les prochains choix stratégiques dans le rapport trimestriel Q4 2025. Comme toujours, les contenus les plus exclusifs sont réservés aux membres des Clubs.
Compte et carte : on y est !
Le premier chapitre de ce rapport ne pouvait être consacré qu’à la fonctionnalité qui a absorbé quasiment toute notre énergie en 2025. Si vous nous suivez sur Discord, vous savez que le parcours a été tout sauf tranquille : entre retards de fournisseurs, complexités juridiques et bugs techniques franchement frustrants — comme des lots entiers de cartes avec un sans contact défaillant — la route a été en pente raide.
Aujourd’hui, nous ouvrons progressivement l’accès aux autres Clubs et prévoyons de rendre la fonctionnalité publique pour tous entre la mi-février et la fin février. Pourquoi pas tout de suite ? Un déploiement progressif nous permet d’identifier les bugs de manière contrôlée et de ne pas surcharger l’infrastructure, tout en garantissant la stabilité de l’ensemble des autres sections de l’app.
On sait déjà ce que vous vous demandez : « Apple Pay et Google Pay, c’est pour quand ? » ou « Comment va-t-on se différencier des concurrents ? ». Pour l’instant, le produit est dans ce qu’on appelle le Layer 0 (la version de base), mais nous avons déjà une roadmap claire pour les intégrations à venir. Certaines réponses et aperçus techniques sont réservés à la version “Club” de ce report. Si vous n’en faites pas encore partie, le point de départ idéal, c’est le nouveau Club Essential.
MiCA : dépôt formel effectué
2025 se termine par l’atteinte d’un objectif réglementaire majeur, confirmant notre position de leader sur le marché réglementé. Nous sommes fiers d’annoncer qu’après un travail préparatoire intense impliquant toutes les équipes de l’entreprise, nous avons formellement déposé le filing pour obtenir l’autorisation MiCA d’opérer en tant que CASP le 5 décembre 2025. Nous sommes actuellement dans l’attente de la réponse des autorités de surveillance compétentes, avec pour objectif d’obtenir l’approbation définitive d’ici juin 2026, la date prévue par la réglementation.
Cette étape marque la conclusion naturelle d’un parcours entamé il y a plusieurs mois et réaffirme notre volonté d’opérer dans le cadre réglementaire le plus avancé d’Europe, en plaçant la transparence et la protection des investisseurs au premier plan.
Il est important de préciser que, grâce au régime transitoire prévu par la réglementation italienne, notre activité se poursuit sans interruption et en pleine conformité. Pour vous, cela signifie que vous pouvez continuer à utiliser chaque service de la plateforme en toute sérénité, sans devoir effectuer la moindre action, avec la garantie que vos actifs sont gérés selon les normes de sécurité les plus élevées. Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’issue de la procédure, fiers d’avoir tenu nos engagements envers notre communauté et prêts à ouvrir 2026 sous le signe de la conformité européenne totale.
En parallèle du parcours MiCA, le travail sur la fonctionnalité Futures continue, étroitement lié à celui-ci. Le développement technique a été mené à bien et le service, ainsi que les autres fonctionnalités de la plateforme, ont été entièrement présentés et détaillés dans le dossier MiCA soumis aux autorités. Nous attendons donc le retour officiel afin de définir le cadre opérationnel final. Fidèles à notre principe de protection maximale de l’utilisateur, nous abordons cette étape avec la prudence nécessaire, avec l’objectif de lancer le service dès que chaque aspect de conformité sera parfaitement aligné sur les standards requis.
Club Essential : la porte d’entrée vers l’écosystème
Le lancement de ce nouveau niveau au T3 2025 part d’un constat simple : le succès du token YNG. L’appréciation du prix au cours de l’année est un signal positif pour la santé de l’écosystème, mais elle a rendu l’accès aux Clubs historiques nettement plus coûteux. Malgré notre mécanisme de rééquilibrage dynamique, le seuil du Club Bronze a par moments atteint 1 000 €, devenant un frein pour les nouveaux utilisateurs.
Le Club Essential est notre réponse : un seuil d’entrée actuellement fixé à 130 YNG, qui permet à chacun de commencer à faire les choses sérieusement sans attendre d’atteindre les niveaux supérieurs.
Les avantages « Essential », en bref :
- Trading : 5 % de réduction sur les frais.
- Staking : +1 % d’APY supplémentaire.
- Cashback : 0,10 % sur les achats effectués par carte de débit (au lancement du compte).
- Opérations : 2 Smart Trade activables.
- Information : accès aux rapports de marché mensuels et à la version complète du rapport trimestriel YNG.
Voyez l’Essential comme un point de départ, pas comme une finalité. C’est la meilleure façon de tester les avantages de la plateforme Young Platform avec un engagement limité. Une fois les bénéfices constatés dans votre utilisation quotidienne, le passage aux Clubs “OG” (Bronze, Silver, Gold et Platinum) deviendra l’étape naturelle pour celles et ceux qui recherchent des bonus, des réductions et un cashback exponentiellement plus élevés.
Comme pour tous les autres niveaux, les 130 YNG requis ne représentent pas un coût : ils sont simplement bloqués sur la plateforme et restent entièrement votre propriété.
Les événements stratégiques et l’avenir de Young Group
S’il fallait choisir un mot-clé pour décrire une partie de la vision de Young Platform pour 2026, ce serait, sans hésiter, la présence dans le monde réel. Par le passé, nous avons organisé des initiatives en présentiel de manière sporadique ; à partir de cette année, nous avons décidé de changer radicalement d’approche en adoptant un plan structuré et récurrent. Nous sommes pleinement conscients que tout ce que nous avons construit, nous le devons à notre communauté, et nous ressentons le besoin de redonner quelque chose de tangible, en renforçant un lien qui, trop souvent dans le monde crypto, reste enfermé derrière un écran.
Notre stratégie s’articule autour de deux axes principaux, visant à la fois l’inclusivité maximale et la valorisation de nos soutiens les plus fidèles. D’un côté, nous organisons des meet-ups informels ouverts à tous, pensés pour se rencontrer, discuter du marché et apprendre à se connaître sans filtre. De l’autre, nous concevons une série d’événements exclusifs dédiés aux membres des Clubs et à des investisseurs sélectionnés. Nous voulons que l’appartenance à un Club devienne un avantage concret : un moyen de briser le « quatrième mur » et de vous faire entrer directement dans notre quotidien.
Mettre un visage à notre travail n’est pas une formule : c’est un acte de responsabilité. Chacun d’entre nous — du management à l’équipe technique — veut échanger avec vous pour vous faire part de l’engagement et de la passion que nous mettons à construire l’écosystème Young. Et rendre les clubs toujours plus attractifs grâce au contact humain est notre priorité : nous croyons que la confiance se construit en se regardant dans les yeux et en partageant la vision d’un futur financier plus accessible et plus transparent.
Les concours: « The Reveal »
La saga des concours de Young Platform a été l’un des principaux moteurs de notre 2025, se transformant en un véritable voyage narratif capable d’embarquer la communauté bien au-delà du simple aspect des récompenses. Tout a commencé avec The Box, le chapitre consacré à faire sauter les préjugés financiers, suivi de The Unbox, l’étape clé qui a servi de pont stratégique vers l’arrivée du compte et de la carte. Le succès de cette dernière a été exceptionnel : grâce au mécanisme Boost Holder, qui récompensait la détention de YNG par des gemmes bonus, l’activité sur la plateforme a atteint des pics de participation comparables à ceux des moments d’euphorie maximale du marché. Cet engagement s’est traduit par une performance économique marquante, avec un volume d’échanges total de 19,7 millions d’euros, soit une hausse spectaculaire de 8 000 % par rapport au T3 2024.
Le 9 décembre 2025, nous avons lancé le dernier épisode — et le plus ambitieux — de cette trilogie : The Reveal. Si les chapitres précédents servaient à préparer le terrain, cette nouvelle phase incarne la “Révélation” de la réalité au-delà des apparences, avec le plus gros prize pool de notre histoire. Pour ce concours, qui se terminera le 10 mars 2026, nous avons choisi de faire évoluer les mécaniques de jeu en nous appuyant sur notre expérience. La structure se divise en deux compétitions parallèles : le Championnat, basé sur un classement général qui récompensera la régularité avec des prix iconiques comme une Rolex Submariner ou une moto KTM 125 Duke ; et les Tournois, six mini-défis bimensuels permettant à un nombre bien plus large de participants de remporter des récompenses par tirage au sort.
La véritable innovation de The Reveal réside dans la démocratisation du système. En analysant les données de The Unbox, nous avons constaté que ceux disposant de moyens financiers plus importants tendaient à concentrer une proportion disproportionnée de tickets. Pour corriger ce déséquilibre, nous avons introduit un système par paliers (Tier) pour débloquer les “tickets chanceux” : désormais, plus on cumule de gemmes, plus il devient “coûteux” d’en obtenir de nouvelles. Ce mécanisme par tranches permet aussi à ceux qui ont moins de gemmes de rester compétitifs, au point qu’une seule mission peut suffire pour participer au tirage au sort. Ainsi, The Reveal n’est pas seulement un concours : c’est l’aboutissement d’un parcours de transparence qui maintient l’intérêt au plus haut niveau pour l’écosystème — et pour le token YNG, qui continue de profiter de la demande générée par les missions et des avantages réservés aux holders.
Young Platform Pro
En parallèle de l’expansion de nos services bancaires, nous n’avons jamais cessé de perfectionner le cœur opérationnel destiné aux professionnels du marché. Young Platform Pro a connu une transformation en profondeur. Nous avons adopté l’analogie de l’instrumentation chirurgicale : tout comme un chirurgien a besoin d’outils d’une précision maximale pour opérer en toute sécurité, un trader expérimenté exige une plateforme capable de garantir une réactivité instantanée, un contrôle granulaire et une continuité opérationnelle absolue.
L’interface a été optimisée selon les standards internationaux d’accessibilité et de confort visuel, afin de réduire la fatigue lors des sessions nocturnes et de maximiser la densité d’information sur les écrans modernes. La vraie révolution, toutefois, réside dans la personnalisation totale de l’espace de travail : grâce à un système d’onglets modulaires, chaque utilisateur peut désormais construire son setup idéal, en synchronisant automatiquement dans le cloud chaque layout et chaque analyse graphique de TradingView. Cette flexibilité est aujourd’hui complète grâce à l’intégration de la nouvelle version mobile responsive, qui rend toute la puissance de Young Platform Pro accessible directement depuis le navigateur du smartphone. Concrètement, cela permet de passer du desktop au mobile sans aucune rupture, en emportant avec soi les indicateurs, les trendlines et les études graphiques sauvegardés sur nos serveurs.
Nous avons également renforcé de manière radicale le panneau d’ordres afin d’assurer une vitesse d’exécution inédite, en introduisant des sélecteurs en pourcentage pour allouer rapidement le capital, ainsi qu’une flexibilité totale dans le calcul des montants, désormais paramétrables également dans la devise de base du pair. Sous le capot, l’intégration des nouvelles API v4 a réduit la latence et renforcé la stabilité : aujourd’hui, l’infrastructure répond aux besoins de celles et ceux qui automatisent leurs stratégies ou nécessitent des flux de données en temps réel. En résumé, Young Platform Pro est désormais un environnement de trading mature et hautement performant, conçu pour celles et ceux qui vivent le marché avec sérieux et professionnalisme.
Comme toujours, nous avons choisi de réserver les analyses les plus stratégiques et les données les plus sensibles exclusivement aux membres de nos Clubs. Ce sont eux les véritables protagonistes de notre écosystème et ils méritent un niveau de transparence sans précédent sur les décisions qui en façonnent l’avenir.
C’est pourquoi, dans la version du report réservée aux membres des Clubs, vous trouverez :
- Actualités sur le compte de paiement et la carte de débit de Young Platform :
- Données exclusives sur les Clubs : chiffres à jour sur les membres et analyse de l’impact de leurs achats sur la performance du token.
- Un aperçu de la future roadmap : nos stratégies et plans pour les prochains listings sur d’autres exchanges centralisés.
Ces approfondissements stratégiques sont une exclusivité pour celles et ceux qui vivent l’écosystème Young Platform en première ligne et veulent comprendre les leviers qui guideront sa croissance. Votre soutien en tant que membre des Clubs est — et reste — notre plus grande ressource. Merci pour votre confiance : on vous invite à continuer à nous suivre dans ce nouveau chapitre de notre aventure.
Les informations relatives au Token YNG sont fournies à titre informatif. Le Token ne représente pas un instrument financier. L’achat et l’utilisation du Token YNG comportent des risques et doivent être évalués avec attention. Ceci ne constitue ni une sollicitation à l’investissement, ni une offre au public au sens du décret législatif italien n° 58/1998.
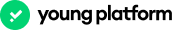
Inscris-toi à un Club